Mise au point commentée
Trois d’entre eux sont actuellement disponibles en France : l’abémaciclib, le palbociclib et le ribociclib. Au vu de leur bénéfice au stade avancé, ces trois thérapies ciblées ont été évaluées à un stade plus précoce de la maladie, notamment chez les patients à haut risque de récidive, dont 24 à 31 % rechutent à 7 ans malgré une chimiothérapie et une hormonothérapie périopératoires considérées optimales [2]. Actuellement, seuls l’abémaciclib et le ribociclib ont démontré une activité suffisamment significative pour devenir un nouveau standard de traitement au stade adjuvant des cancers du sein RH+ [2, 3]. Pour autant, de nombreux travaux sont en cours pour renforcer la position des iCDK4/6 en phase précoce.
Les iPARP sont une nouvelle classe thérapeutique qui a montré son efficacité dans les cancers de la prostate métastatiques résistants à la castration, tout d'abord en monothérapie chez les patients porteurs d’une mutation des gènes de réparation de l’ADN – plus particulièrement des mutations BRCA1/2 -, puis en association avec un ARPI (inhibiteur de la voie des récepteurs androgènes).
L’osimertinib, un ITK EGFR de troisième génération, améliore la SSP par rapport aux ITK de première génération, en particulier chez les patients présentant des métastases du SNC.
L’article explore les possibilités d’associer l’osimertinib à une chimiothérapie ou à d’autres médicaments pour améliorer l’efficacité du traitement et retarder la progression cérébrale.
L’association osimertinib-chimiothérapie a donné des résultats prometteurs avec une amélioration de la SSP et de la SG mais au prix d’effets secondaires plus importants.
Cette option thérapeutique est à discuter pour les populations les plus à même d’en bénéficier.
À la suite de quatre essais majeurs de phase III (PAOLA-1, SOLO-1, PRIMA et ATHENA-MONO), les PARPi ont été positionnés comme un nouveau standard de traitement de maintenance de première ligne des CSOHG, avec un bénéfice différent selon le statut HRD. Le corollaire réside dans le fait que l’évaluation du statut HRD à l’aide de tests moléculaires compagnons (CDx) est un point majeur dans la prise en charge optimale des CSOHG.
Au cours des 2 dernières années, de nombreux CDx ont été développés en alternative au test princeps proposé par Myriad Genetics. Le point clé de la validité de ces tests repose sur une double validation: analytique et clinique. Cette revue a donc pour objectif d’aborder les bases mécanistiques du statut HRD, son impact théranostique dans les cancers de l’ovaire, les CDx utilisables en pratique clinique et un focus sur l’intérêt grandissant du statut HRD dans les cancers de l’endomètre.

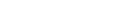 pour accéder à ce contenu.
pour accéder à ce contenu.








